
Patrick De Jonghe
Il publie en 2007 un premier roman : L'Illusion de la Liberté. En 2010, les Editions du Bord du Lot publient son deuxième roman : Sous le Saule (voir page 3)
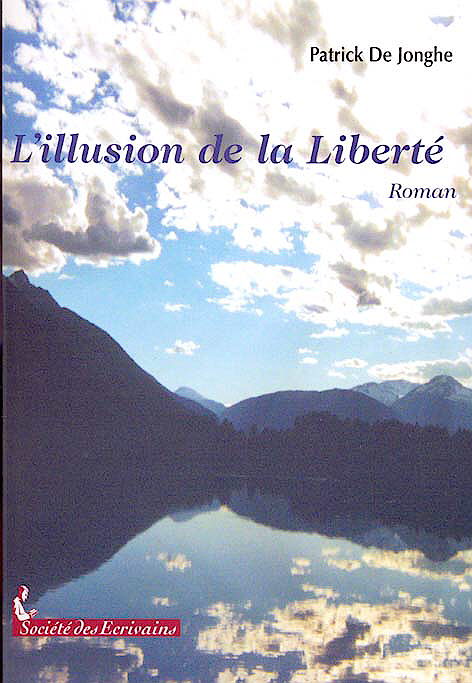

Comment se procurer "L'illusion de la Liberté" ?
Voir en-dessous des extraits...
L’illusion de la Liberté (extrait 1)
Le vieil homme a ouvert l’album à la première page. Jul grimpe sur le lit, à l’intérieur de l’alcôve de bois, et regarde par-dessus son épaule. Ce sont d’anciennes images aux couleurs un peu délavées. Certaines sont imprimées en noir et blanc. D’autres affichent des teintes variant du sépia à l’ocre.
« C’est quoi ? demande Jul à chaque nouvelle photo.
- Le pays d’où je viens. Ma maison était dans un port, elle aussi, tu vois… Un petit port breton où il faisait bon vivre, avant la guerre…
- Breton ?
- J’habitais en Bretagne. En France… Regarde… »
Jorge a extrait une carte d’Europe d’un tiroir.
« Nous vivons ici, tout en haut. Et moi je viens de là.
- Là, ça fait loin ?
- Tout dépend comment tu te déplaces.
- A pied, bien sûr !
- Alors, c’est un peu loin quand même. En marchant sans nous arrêter, ça nous prendrait… six ou huit mois. Mais notre planète est bien plus grande. Et puis, d’ici, en avion, il ne nous faudrait que quatre heures pour atteindre les environs de mon village…
- Avec un petit avion comme celui qui vient parfois se poser sur l’eau, dans le port ?
- Non. Avec un gros avion, très puissant… Mais il n’en vient jamais par ici…
- Tu me montreras ton pays, un jour ? »
Le vieil homme ne dit rien. Que peut-il promettre à sa petite fille adoptive ? Quel avenir peut-il lui offrir ? Il a presque quatre-vingts ans. Il n’a plus d’argent pour retourner chez lui. Les pêcheurs du village ne naviguaient pas plus loin que le Tanafjorden, certains s’aventurant parfois plus à l’est, vers Vadsø et le Varangerfjorden, près de la frontière russe. Aucun d’entre eux n’accepterait d’embarquer Jorge et Jul dans un long périple vers le sud, pour quelques centaines de couronnes. Et la ligne officielle revenait trop cher.
L’enfant continue à tourner les pages de l’album, tandis que le vieillard contemple la lettre ouverte sur la table mal équarrie. Qu’a-t-il fui, pendant toutes ces années ? Sa jeunesse est si loin. Quel est encore le sens de sa présence ici ? Quel est le sens d’une vie, de toute façon ? songe-t-il. Je suis tuméfié par la peur de la mort qui approche, par la cruauté du monde, par l’oubli dans lequel chacun finit par sombrer un jour, même le Christ ou Bouddha ou les réincarnations successives du Dalaï Lama - que seront-ils encore dans cent millions d’années? Je suis anéanti par ma honte d’être si faible et d’avoir fui, de m’être refusé à affronter mon passé. Je suis parvenu à vaincre ma peur des autres. Mais je n’ai pu chasser la méfiance et le mépris. Il m’arrive de rester des heures à regarder changer la lumière sur la montagne, mais un homme qui se vante de sa pêche m’agace après cinq minutes…
« Et ça, grand-père ?
- Ca… c’est une belle jeune femme et son bébé, tu vois…
- Et à côté ?
- A côté, c’est moi.
- Alors, tu as eu un bébé !
- Pas vraiment moi, évidemment. J’ai fait un bébé à la jeune femme…
- Donc, tu étais le papa du bébé.
- Oui. Et la jeune dame était sa mère…
- Comment s’appelait-elle ?
- Mathilde.
- C’est elle qui vivait avec toi, ici ?
- Non. C’est une autre femme qui vivait ici.
- Pourquoi ? »
Jorge regarde Jul et se tait. Pourquoi ? Que devait-il répondre ? Que devait-il raconter à Jul, la petite fille que l’on avait posée devant sa porte un soir de Noël pour qu’il en prenne soin ? Et qu’avait-il fait d’autre ou de mieux que d’abandonner lui aussi un bébé, quarante-trois ans plus tôt, pour entamer sa longue marche vers le Nord ?
« Parce que j’ai… quitté Mathilde. Ou plutôt, c’est elle…
- Pourquoi ?
- Ce sont des histoires de grandes personnes, Jul !
- Et le bébé, il s’appelait comment ?
- Le bébé… Le bébé n’existe plus. Il est mort… Voilà.
- Tu es fâché ?
- Parfois, il faut s’arrêter de poser des questions. Il y a des phrases qui font mal. Tu comprends ?
- Tu es triste alors ? Tu n’es pas fâché, mais tu es triste, c’est ça ? Parce que ton bébé est mort… »
Le vieil homme se lève et regarde la mer à travers la vitre. La silhouette d’un voilier se dessine à l’horizon. Le soleil joue avec les nuages. Le vent siffle dans le toit de la cabane.
« Je voudrais qu’on parle d’autre chose, Jul… Viens voir comme la lumière est belle…
- Et ma mère à moi ? »
Jorge se tourne vers la petite fille. Il y a un très long silence. Jul soutient le regard de son grand-père.
« Ta mère… Je ne sais pas.
- Tu es sûr…
- Je t’ai déjà tout raconté. Je ne peux pas faire de miracle. Peut-être la retrouveras-tu plus tard. Peut-être… Tu sais, j’ai réfléchi : si je devais partir un jour, je pense qu’il vaudrait mieux que je te confie à…
- Si tu pars, je viens avec toi !
- Je suis très vieux, Jul. Quand je parlais de partir… ce serait pour un autre voyage que celui que tu crois ! Je suis sûr qu’en discutant avec l’institutrice, je pourrais trouver une famille qui accepte de s’occuper de toi.
- Tu ne peux pas. Il faut d’abord que tu me montres ton pays. Tu as promis.
- Je n’ai rien promis. Je n’ai pas l’argent pour faire ce voyage.
- Je travaillerai.
- Tu as six ans !
- J’irai travailler sur un bateau. »
Le vieillard éclate de rire.
« Tu as six ans et tu iras à l’école comme tous les enfants !
- Je ne suis pas comme tous les enfants, réplique Jul. Je n’ai pas de maman. »
Le sourire du grand-père s’éteint. Il pose la paume d’une main ridée contre le visage frais de la fillette. Le voilier s’est rapproché et les premiers bateaux de pêche rentrent au port, suivis de leurs cohortes de mouettes et de goélands…
L’illusion de la Liberté (extrait 2)
Un jour, au retour de l’école, Maman m’avait présentée à un homme que je ne connaissais pas. Il était jeune. Il avait les cheveux noirs coupés à la mode et des yeux marron. Il portait un jeans, un sweater et des baskets. Il souriait.
« Jean-Claude est psychologue, Marie. Il voudrait t’aider…
- Je n’ai pas besoin d’aide.
- Tu sais bien que si ! », s’exclama ma mère, encouragée par le fait que j’aie pris la peine de répondre. C’était la première fois que j’ouvrais la bouche depuis une semaine. Je regardai Jean-Claude qui souriait toujours.
« Je suis désolée, Monsieur. Vous êtes venu pour rien », dis-je d’une voix neutre. J’allais disparaître une fois de plus dans ma chambre quand il répliqua :
« Il ne suffit pas de s’excuser. Cela ne répare rien. Nous sommes vendredi soir. J’ai annulé un autre rendez-vous pour venir te voir. Un rendez-vous avec une jeune femme que j’avais invitée à souper. »
Il avait pris une voix sévère. Exactement celle qu’il fallait pour me donner mauvaise conscience. Evidemment, sept ans plus tard, je me rends compte de la manipulation. Mais il jouait bien la comédie et après l’avoir dévisagé une nouvelle fois, je m’étais persuadée qu’il était vraiment fâché.
Je m’assis sur une chaise sans rien dire et sans le quitter du regard. Je lui signifiais ainsi ma soumission aux règles élémentaires de courtoisie, sans lui accorder la victoire de m’arracher une parole de plus. Il était venu pour me voir. Il me voyait. Jean-Claude s’était remis à sourire. Maman avait disparu en direction du garage où je l’entendais chipoter aux vélos qu’elle s’était récemment mise en tête de rafistoler. Pour le reste, le lieu semblait désert. Aucun son ne parvenait jusqu’au salon, bien que je sache Papa et le reste de la famille présents dans la maison. Jean-Claude se leva et fit lentement le tour de la pièce en commentant la décoration et l’ameublement. Je commençais à regretter de ne pas m’être réfugiée dans ma chambre…
« Joli tableau ! Tes parents sont amateurs d’art ?… Vous êtes bien situés ici, loin de la ville… Il fait calme. La campagne est splendide. Ces champs à perte de vue… Quelle belle maison ! Tu en as de la chance ! Je rêve d’un feu ouvert comme le vôtre… Mais en ville, dans mon petit appartement… Vous avez des animaux ? C’est l’endroit rêvé pour un chien. Tu ne te promènes jamais dans les champs ? »
Je le laissai parler. J’avais décidé de ne rien dire. De toute façon, il ne racontait rien d’intéressant. Mais tout à coup, il s’exclama :
« Entre nous, tes parents sont de fameux imbéciles, tu ne trouves pas ? »
Je sursautai.
« Ce ne sont pas mes parents, dis-je malgré moi. Et ce ne sont pas des imbéciles. Vous n’avez pas le droit de dire ça ! Psychologue ou pas, vous n’avez pas le droit. Je leur raconterai.
- Ce sont des imbéciles, continua-t-il, parce qu’ils n’ont rien compris. Ils ne savent pas ce que c’est de se sentir seul au monde…
- Vous non plus !
- C’est ce que tu crois…
- Vous n’êtes pas seul au monde. Vous deviez sortir avec quelqu’un ce soir !
- C’est vrai. Pourtant, moi, je suis orphelin. J’avais douze ans quand j’ai perdu mes parents. Et je peux te jurer que cette blessure-là ne sera jamais cicatrisée. Mais j’ai appris à vivre avec un vide au fond de moi. Il fallait bien…
- Au moins, vous avez connu vos vrais parents !
- Tu connais tes parents, Marie. Tes parents sont ceux qui t’ont élevée. Même s’ils sont idiots de ne pas t’avoir tout raconté depuis le début…
- Vous n’avez pas le droit de dire qu’ils sont idiots. Moi, j’ai le droit. Pas vous.
- Et puis, ta maman est ta vraie mère. Tu n’es pas orpheline, toi !
- Elle n’est plus ma mère. C’est une étrangère ! »
J’étais furieuse contre ce type qui venait insulter ma famille dans notre maison, sous notre toit ! Pour qui se prenait-il ? Et moi, qu’est-ce que je faisais de mon serment de ne pas lui adresser la parole ? Je me pinçai les lèvres, résolue à ne plus rien dire.
« Tu as raison. C’est une étrangère. A ta place, je claquerais la porte ! »
Là, il prenait un risque. Un gros. Mais il savait très bien ce qu’il faisait. Il avait commencé par me monter contre lui, puis il me conseillait de faire exactement ce que j’avais en tête. Il avait deviné que je songeais à quitter la maison, alors il m’y poussait. Et comme je ne voulais surtout pas suivre ses conseils, je me révoltais contre sa proposition. En même temps, il me forçait à défendre mes parents. Je ne pouvais pas supporter qu’il dise du mal d’eux. C’était plus fort que moi. Il se rassit et me regarda en souriant.
« Finalement, ce n’est pas plus mal que tu ne les considères pas comme tes parents. Tu n’as pas l’air d’avoir mené une vie très heureuse, ici. Malgré la belle maison, la campagne, toutes ces jolies choses qui t’entourent… Il semble qu’on ne t’ait pas donné beaucoup d’amour. Je suppose que tes parents ont fait appel à moi uniquement pour se donner bonne conscience…
- Quoi ! », m’écriai-je, rompant mon serment pour la deuxième fois. « Vous ne comprenez rien, rien du tout ! Ils vous ont appelé parce qu’ils savent que je suis malheureuse. Pour que vous m’aidiez ! Et vous n’arrêtez pas de les critiquer !… Vous devriez avoir honte !
- Bon. Excuse-moi. Je suis incorrigible. Mais ta situation me touche tout particulièrement, tu comprends ?…
- Non.
- Tu me donnes l’impression de détester ceux qui t’ont élevée. Je me dis que c’est un fameux gâchis. Si j’avais eu la chance d’être adopté, à la mort de mes parents, je crois que j’aurais nagé dans le bonheur. Tout m’aurait semblé mieux que l’orphelinat !
- Ce n’est pas pareil ! Pour moi, c’est l’inverse. Tout était beau et puis tout est devenu laid et triste ! Et je ne déteste pas mon père et ma mère !
- Alors, je me suis trompé… »
Il venait de me faire dire exactement ce qu’il voulait entendre. Mais il eut la bonne idée de ne pas triompher, ce qui eût tout gâché. Il murmura :
« Bon. J’ai dit assez de bêtises. Je m’en vais. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. »
Il enfila sa veste qu’il avait déposée sur le dossier d’un fauteuil.
« Tu salueras tes parents de ma part », dit-il avant de sortir dans la nuit.
Il avait disparu si brusquement que je me retrouvai abasourdie, dans le hall, une foule de questions et de réponses tournoyant dans ma tête.
Maman avait émergé du garage en entendant claquer la porte.
« Il est parti ?
- Oui ! » dis-je.
Et je m’effondrai dans ses bras en pleurant…
L’illusion de la Liberté (extrait 3)
« Comment ça va ?
- Comme on peut…
- Tu ne t’habitues pas à Melbourne?
- Ni à Melbourne, ni au reste…
- Tu ne connais personne ?
- Non. Juste un type, au bureau. Il essaye de m’inviter à dîner, mais je refuse chaque fois. Ca ne m’intéresse pas.
- Il n’y en a pas d’autre ?
- Non.
- Tu es donc si seule ?
- J’ai Mary… et mes parents.
- Mary… Où est-elle ?
- A la crèche.
- Pourquoi ? Je croyais que tu ne travaillais pas aujourd’hui.
- Pour pouvoir te parler tranquillement.
- Elle est envahissante ? »
Doris a un sourire fugitif. Le premier depuis l’arrivée de Vera.
« Elle vient d’avoir trois ans ! Elle ne parle que d’elle et essaye de mobiliser l’attention de tout le monde.
- Ca ne se passe pas un peu plus tard, ça ?
- Je ne crois pas… Ca dépend des enfants…
- J’aurais voulu la voir !
- J’irai la chercher tout à l’heure… »
Vera contemple sa jeune amie, si pâle avec son regard fixe et se yeux embués.
« Tu n’as pas l’air bien, tu sais…
- Je déprime.
- J’ai souvent pensé à toi… Tu as des nouvelles de Jerry ?
- Aucune… L’argent est versé à date fixe sur le compte. C’est tout.
- Tu espères encore ? »
Doris baisse la tête.
« Bien sûr que j’espère… Je n’arrive toujours pas à y croire ! Je sais que c’est stupide. Je devrais sans doute refaire ma vie. Je ne peux pas, Vera. Maintenant, je serais prête à aller au bout du monde avec Mary et lui. C’était juste que, lorsque j’étais enceinte, j’avais peur. Je voulais un cocon. Il était égoïste mais moi, je ne tenais aucun compte de lui non plus. Je lui décrivais un avenir si classique, si éloigné de ses rêves… »
Elle met ses mains en poche et se campe face à la fenêtre, au troisième étage d’un immeuble modeste de Melbourne. Elle a refusé l’aide de ses parents qui habitent le quartier chic de Balwyn et ont proposé de lui acheter un bungalow confortable, entouré d’un jardin, près de Beckett Park.
Au pied du bâtiment, les tramways verts se frayent un chemin dans la circulation dense et le son des avertisseurs parvient jusqu’à elle. Un courant d’air enveloppe son visage. Les carreaux sont sales. Il pleut, malgré l’été chaud et généralement assez sec.
« Chaque fin de semaine, je passe une journée à Blairgowrie. J’erre sur la jetée. Je pose des questions. Je mange un sandwich avec Mary. Puis on se promène sur la plage. Mary joue dans le sable et moi, je regarde la mer, les vagues, et je rêve que l’une d’entre elles me ramène Jerry… »
Elle se met à pleurer.
« C’est con, non ? »
Puis, se reprenant :
« Et toi ? Comment vas-tu ? Et Olav ?
- Olav est très occupé. Il prépare son voyage en Europe. Il veut revoir sa famille… Il connaît beaucoup de monde un peu partout. Un de ses fils vit en Allemagne, l’autre en France…
- Tu ne l’accompagnes pas ?
- Non. Je n’ai aucun bon souvenir, là-bas… J’y ai passé mon enfance, c’est suffisant. Olav a dit qu’il se renseignerait pour toi. Son fils travaille dans une compagnie maritime. Ils affrètent des bateaux pour le transport de marchandises et de pétrole dans le monde entier. S’ils aperçoivent Jerry et son voilier… Qui sait ?
- Ca changerait quoi ?
- Au moins, tu saurais où il est, vers où il navigue…
- Ca ne me le rendra pas…
- Je sais… »
La pluie a cessé.
« Viens ! dit Doris. On va récupérer Mary et je t’invite à dévorer un meatpie, une salade et des cookies au Joanie’s tea rooms’.
- D’accord. Mais juste une salade pour moi. Je suis au régime !
- Toi ?
- Il faut que je redevienne séduisante ! Olav s’en va : le champ est libre ! Après tout, je n’ai que cinquante deux ans !
- Tu parles sérieusement ?
- Non… Mais on ne sait jamais. Et puis, lorsqu’il reviendra, il faudra que je lui plaise encore, tu ne crois pas ?
- Tu es sûre qu’il reviendra ?
- Evidemment ! Il est comme ta fille. Il ne parle que de lui-même. Je suis la seule à pouvoir le supporter. Toutes les autres l’ont abandonné après quelques mois… »
Doris éclate de rire :
« Je ne le voyais pas aussi insupportable !
- C’est bon de te voir rire, tu sais ça ?…
- Allons-y ! »
Elles claquent la porte derrière elles et dévalent dans l’obscurité les trois étages qui les mènent au rez-de-chaussée, l’éclairage de la cage d’escalier étant une nouvelle fois en panne…
L’illusion de la Liberté (extrait 4)
Mary fêtera bientôt ses cinq ans. En octobre, Doris, dépressive, a perdu son travail. Elle n’ose pas en parler à ses parents.
C’est presque le début de l’été et la canicule n’a pas épargné Melbourne. Doris habite toujours son petit appartement. Il y fait torride. Ses parents ont refusé catégoriquement de lui financer son voyage en France. Chez eux, la générosité suit certaines règles : le portefeuille ne s’ouvre que pour des projets qu’ils approuvent. Ils auraient été prêts à installer leur fille dans un bungalow à Beckett Park, près de chez eux, mais Doris a choisi un appartement minable dans un quartier infesté de Vietnamiens. Pire, elle s’est endettée pour l’acquérir ! Elle a inscrit Mary à une école publique – pas même à un établissement religieux. Et voilà que maintenant elle compte perturber sa fille – leur unique petite fille – en se lançant à la poursuite de son païen de père ! En France ! A l’autre bout du monde ! Où l’on ne parle même pas l’anglais ! Où la nourriture est trop riche, où l’on mange de la viande crue et des escargots ! Et puis, une jeune femme seule avec son enfant ne voyage pas dans des contrées lointaines, où elle ne connaît personne ! Doris n’a pas insisté. Les préjugés de ses parents ne sont qu’un prétexte : ils n’ont jamais supporté Jerry et ne lèveraient pas le petit doigt pour l’aider. Lorsque Mary a lancé, en plein milieu d’une conversation animée : « Je veux voir mon papa ! », ses grands-parents ont cajolé leur petite fille avec tendresse et pitié, lançant des regards furieux à Doris :
« Ce n’est pas encore le moment… », ont-ils murmuré à l’oreille de Mary. « Plus tard, quand tu seras grande ! »
Sa mère a pris Doris à part et lui a fait des reproches :
« Tu traumatises cette pauvre gamine ! C’est honteux ! »
Doris n’a pas répondu.
Olav est revenu d’Europe sans information nouvelle. Le couple se préoccupe énormément de Mary et sa maman. Mais il leur est impossible de les aider financièrement. Eux-mêmes sont endettés.
Enfin, en désespoir de cause, Doris s’adresse au père de Jerry, avec qui elle s’est pourtant juré de ne jamais entrer en relation. Tout au début, elle a espéré qu’il s’intéresse à Mary. Mais comme aucun signe de sa part ne lui est parvenu, en dehors de cette première visite éclair à la maternité, cinq ans auparavant, elle a exclu cet homme de sa vie et de celle de sa fille. Mary est stupéfaite d’apprendre qu’elle a un second grand-père. Quand elle entre en compagnie de Mum dans le grand immeuble moderne du centre d’affaires de Melbourne et rejoint le cinquante-deuxième étage dans un ascenseur rapide et silencieux, Mary affiche un air si ébahi que Doris doit lui rappeler de fermer la bouche pour qu’une mouche n’y entre pas. Elles s’assoient dans les confortables fauteuils en cuir qu’on leur désigne. Elles ne doivent pas attendre longtemps. Un homme vient à leur rencontre, sourire aux lèvres, et les invite à entrer dans son bureau. Il y fait frais. La pièce est gigantesque et surplombe la ville. Mary se précipite à la fenêtre. Elle n’a jamais rien vu de pareil !
« Café ? » demande le père de Jerry à Doris qui le contemple, découvrant la copie plus âgée de celui qu’elle a perdu de vue depuis si longtemps.
« Et toi, Mary ? Un jus d’orange ? »
La petite fille se tourne vers lui :
« Comment je dois t’appeler ? Je ne t’ai jamais vu !
- Nous nous sommes déjà rencontrés… Il y a bien longtemps, dit-il d’une voix chaude. Tu étais trop petite pour t’en souvenir. En fait, tu venais de naître… Alors, ce jus d’orange ?
- Je t’appelle comment ? insiste la petite fille.
- Appelle-moi Bill, comme tout le monde…
- Ce n’est pas un nom de grand-père, ça ! Et puis Bill, c’est moche !
- Mary ! »
Doris roule des yeux furieux. L’homme aux cheveux gris sourit :
« Bill, c’est le diminutif de William…
- Alors, je t’appellerai grandpa William !
- Voilà qui est réglé… Quant au jus d’orange…
- Je n’aime pas le jus d’orange, je préfère le jus de pomme ! », lance Mary. Puis, d’un ton plus doux, comme si elle lui pardonnait : « mais si tu n’as rien d’autre, je veux bien, grandpa William… »
Bill lui verse un verre de jus d’orange avec lequel elle disparaît pour coller son nez à la vitre. Il vient s’asseoir près de Doris. Elle lui est reconnaissante de ne pas s’être installé dans son magnifique fauteuil directorial, dans lequel il l’aurait dominée. Il observe encore Mary quelques instants :
« Je parie qu’elle adore le jus d’orange. C’était juste une vengeance parce que je ne me suis jamais occupé d’elle… »
Il se tourne vers Doris :
« N’est-ce pas ? »
Doris sourit.
« Vous êtes un fin psychologue… Vous n’avez pas pu lui manquer. Elle ignorait votre existence… »
Bill la dévisage quelques instants. Il la trouve belle. Belle et triste. Il songe à Jerry. Quel imbécile ! se dit-il.
« Je vous écoute… »
Il ne regarde pas sa montre. Pas une seule fois. Il a pourtant déjà pris du retard. Doris s’en rend compte lorsque, au beau milieu de ses explications, une secrétaire frappe à la porte et dépose une liasse des papiers sur le bureau en marmonnant :
« Ces messieurs de la commission paritaire attendent à côté !
- Servez-leur à boire et dites-leur que je les rejoindrai plus tard.
- Oui, mais le président du conseil…
- Faites ce que je vous dis, Elizabeth ! Si pour une fois je suis un peu en retard, le bâtiment ne s’effondrera pas !… »
La secrétaire prend un air pincé et sort prestement.
« Si ma femme n’était pas morte d’un cancer du sein après que Jerry eut claqué la porte de notre maison, elle aurait applaudi à deux mains ce que je viens de faire… J’ai toujours été terriblement ponctuel et je déteste être pris en défaut... »
Puis il sourit encore une fois à Doris :
« Mais, dans certaines circonstances, les minutes valent la peine d’être détournées du droit chemin. Il y a des priorités dans l’existence. C’est ce que je n’ai cessé de répéter à Jerry lorsqu’il se bagarrait contre les gens de mon espèce – les exploitants, les esclavagistes, comme il me qualifiait !… Continuez Doris. Continuez à me parler de lui avec un autre regard que le mien ! L’égoïsme de mon fils m’a écœuré pendant tant d’années… »
L’homme semble avoir vieilli en quelques minutes. Il a rentré la tête dans les épaules. Son regard s’est voilé. Lorsque Doris aborde la question de l’argent qu’elle souhaite lui emprunter, il se lève d’un bond :
« Il n’est pas question que vous m’empruntiez quoi que ce soit ! », dit-il d’une voix forte.
Doris se lève à son tour. Mary renverse son jus d’orange sur la moquette et vient se blottir près de sa mère qui semble prête à partir.
- Je pensais… Je croyais… Excusez-moi ! », balbutie Doris.
Elle se rassied sur le rebord du fauteuil, Mary sur ses genoux.
- Mais… »
Il a sorti son carnet de chèques :
Il signe le chèque et le fourre dans la main de Doris, ébahie.
« Je ne veux pas revoir un seul cent de cet argent ! Vous comprenez ? Quant à ce que je vous verse tous les mois pour vivre, je vais le doubler. Pour vous aider à rembourser votre appartement !
- Ce que VOUS me donnez ! ? Ce n’était donc pas Jerry !
- Jerry n’a pas d’argent. Il n’a que son bateau et quelques économies. Je lui ai coupé les vivres depuis qu’il vous a quittée… »
Il les accompagne jusqu’à la porte de son bureau.
« Grandpa William, tu es encore fâché ? demande Mary.
- Fâché ? Fâché pourquoi ?
- Parce que j’ai renversé mon jus d’orange sur le tapis… »
Bill éclate de rire. Puis soudain, il prend Doris par les deux mains, la fait pivoter vers lui et murmure :
« Retrouvez-le ! Retrouvez-le avant qu’il ne soit trop tard ! »
La lourde porte décorée de cuir vert foncé se referme sur lui.
Doris glisse le chèque dans son sac sous le regard scandalisé de la secrétaire à qui Mary fait un pied de nez juste avant de s’engager dans l’ascenseur.
où se procurer "l'illusion de la Liberté" ?
Quelques exemplaires sont encore disponibles à l'UOPC (14-16 avenue Demey - 1160 Bxl) et chez TROPISME (Galerie des Princes, 11 - 1000 Bruxelles)
ainsi que, bien sûr, chez l'auteur... avec une dédicace en prime !
